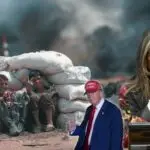La « guerre des 12 jours » entre Israël et l’Iran a marqué un tournant géopolitique au Moyen-Orient. Déclenchée par l’opération israélienne « Narnia » contre l’Iran et soutenue par l’opération américaine « Marteau de Minuit » visant les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan, cette confrontation s’est conclue par un cessez-le-feu fragile, négocié par les États-Unis et le Qatar. Loin d’atteindre ses objectifs stratégiques, Israël a révélé ses vulnérabilités face à une riposte iranienne ciblée, « Promesse honnête 3 », qui a frappé durement Tel-Aviv. Alors que la censure militaire israélienne a tenté de minimiser l’ampleur des destructions, l’Iran a consolidé son statut de puissance régionale incontournable, non pas au nom d’une cause extérieure comme la Palestine, mais en réponse directe à l’agression israélienne.
Les limites de la stratégie israélienne
L’opération « Narnia », lancée par Israël, visait à neutraliser le programme nucléaire iranien. Cependant, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que 400 kg d’uranium enrichi à 60 %, proche du seuil militaire de 90 %, avaient été évacués avant les frappes, préservant la capacité nucléaire iranienne. Selon un rapport du renseignement américain, rapporté par le Washington Post, les destructions infligées aux sites de Fordo, Natanz et Ispahan n’ont retardé le programme que de quelques mois, loin de l’objectif d’élimination totale.
Les défenses antimissiles israéliennes, notamment le système Arrow, ont montré leurs limites face aux missiles iraniens de plus en plus sophistiqués. Des sources militaires ont expliqué que les systèmes de défense antimissile israéliens ont baissé drastiquement leur taux d’interception des projectiles iraniens en passant de 90% à 65 % au fil des jours.
Une source militaire citée par le New York Times indique que les stocks de munitions défensives israéliennes ne pouvaient tenir que 10 jours supplémentaires sans réapprovisionnement américain. Cette pénurie a permis à l’Iran de maintenir des salves de 20 à 30 missiles par vague, visant des cibles stratégiques avec une précision accrue.
Une interview accordée à la BBC le 25 juin 2025 révèle que la censure militaire israélienne a masqué l’ampleur des dégâts, notamment la destruction de quartiers entiers à Tel-Aviv, suscitant une indignation croissante dans la société israélienne.
Ici, dans le centre de Tel Aviv, tout est détruit et les destructions sont généralisées, nous ne pouvons même pas faire de reportage à proximité des zones militaires qui ont été touchées ».
La dépendance d’Israël envers les États-Unis s’est également avérée déterminante. Le président américain Donald Trump, réticent à engager une guerre prolongée suite à ses promesses électorales de désinvestissement militaire au Moyen-Orient, a limité l’opération à des frappes ciblées, refusant une campagne militaire massive.
Cette prudence et les difficultés à contenir les frappes iraniennes a forcé Israël à accepter un cessez-le-feu négocié par le Qatar. Cette nécessité de permettre aux israéliens de dormir en dehors des bunkers après 12 jours de bombardements a révélé la fragilité stratégique d’Israël face à un adversaire résilient.
La riposte iranienne : une démonstration de force
L’opération iranienne « Promesse honnête 3 » a marqué un tournant par son intensité et sa précision. Contrairement aux frappes symboliques sur la base américaine d’Al-Udeid au Qatar, destinées à envoyer un message politique, les attaques sur la capitale israélienne Tel-Aviv, sur des bases militaires à travers le pays, sur le port de Haïfa ou encore sur des cibles stratégiques comme un centre du Mossad ont causé des dommages significatifs.
Ces frappes ont démontré la capacité de l’Iran à projeter sa puissance militaire directement sur le territoire israélien. Un conseiller de l’ayatollah Ali Khamenei a déclaré que « la partie n’est pas terminée », soulignant la préservation du savoir-faire nucléaire iranien malgré l’assassinat de plusieurs scientifiques.
Une vidéo explicative montre comment les alliés d’Israël, notamment les Etats-Unis, utilisent tous les moyens militaires possibles afin de détruire les missiles tirés depuis l’Iran.
L’Iran a également protégé ses stocks stratégiques. Selon de nombreux experts, les 400 kg d’uranium enrichi pourraient permettre la fabrication de 5 à 10 bombes nucléaires si métallisés, bien que le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, précise qu’aucune intention imminente n’a été prouvée.
La guerre non provoquée contre deux puissances nucléaires ne peut que rendre Téhéran plus déterminé à développer la bombe », explique sur X le géopolitologue Arta Moeini.
La rupture avec l’AIEA et la fin de la retenue nucléaire
L’Iran a marqué un tournant décisif en refusant les inspections de l’AIEA, accusée de collaboration avec les puissances occidentales. Ce rejet intervient après des années de tensions, l’Iran ayant maintenu une doctrine de non-prolifération militaire, résumée ainsi : « Pas d’armes nucléaires tant qu’il n’y a pas d’attaque ».
L’échec des frappes israéliennes, perçues comme la « dernière solution » pour neutraliser le programme iranien, a conduit Téhéran à abandonner cette retenue. Un responsable iranien a déclaré que l’agression israélienne justifiait une réévaluation stratégique, renforçant l’idée que les pressions occidentales ne fonctionnent plus.
Pour un pays qui a développé une expertise nucléaire et une capacité de production nationale d’équipements nucléaires depuis le lancement de son programme dans les années 1960 (avant la révolution), les aspirations nucléaires ne peuvent être anéanties par des bombes. Elles peuvent seulement être retardées », explique le spécialiste en géopolitique Arta Moeini sur X.
Cette rupture consolide la position de l’Iran comme une puissance autonome, capable de défier les injonctions internationales. Les estimations de 5 à 10 bombes nucléaires potentielles, bien que spéculatives, alimentent les craintes des pays du Golfe, qui redoutent une escalade régionale.
Désormais, nous enrichirons l’uranium selon les besoins, sans aucune condition », a déclaré le député iranien Alaeddin Boroujerdi et membre de la Commission de sécurité nationale.
Ce changement de posture, combiné à la résilience militaire démontrée, positionne l’Iran comme un acteur incontournable au Moyen-Orient.
Le pivot vers la Chine et les tensions avec la Russie
Les failles des défenses antiaériennes iraniennes, exposées par les frappes israéliennes, ont poussé Téhéran à se tourner vers la Chine pour renforcer ses capacités militaires. Des discussions sur l’achat de 40 avions de chasse chinois, J10, et de systèmes de défense antiaérienne avancés, comme le HQ-9, ont été rapportées, reflétant un pivot stratégique face aux limites du soutien russe.
Dès la fin de la guerre, le Ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh s’est rendu en Chine.
Des responsables iraniens ont critiqué Moscou pour ne pas avoir fourni de systèmes S-400 ni d’avions de chasse, commandés depuis plusieurs années, accusant la Russie de privilégier ses propres intérêts et une relation ambivalente avec Israël.
Telle est la nature de la prétendue coopération stratégique avec l’Iran dont parle M. Poutine », a déclaré Ali Motahari, député iranien.
Ce rapprochement avec Pékin, qui a condamné les frappes israélo-américaines et appelé à la stabilité régionale, sert également les intérêts chinois. La Chine voit d’un très mauvais œil une fermeture du détroit d’Ormuz, crucial pour ses flux pétroliers en provenance d’Iran mais surtout d’Arabie Saoudite.
Pendant la guerre, Pékin a appelé les partenaires à « empêcher que les troubles régionaux n’aient un impact plus important sur la croissance économique mondiale ».
Un nouveau rapport de force au Moyen-Orient
Malgré les pertes humaines (610 morts, majoritairement civils, selon l’ONU), l’Iran a consolidé son statut de puissance régionale incontournable. Les frappes iraniennes, en particulier sur Tel-Aviv, ont révélé les limites de l’invincibilité israélienne, tandis que la préservation du programme nucléaire et le pivot vers la Chine renforcent la position stratégique de Téhéran.
En comparaison, la dépendance d’Israël aux États-Unis et sa censure militaire, masquant les destructions à Tel-Aviv, ont entamé sa crédibilité. Le cessez-le-feu reste précaire. Les nouveaux contrats d’armement entre Tel-Aviv et Washington et l’absence de négociations sur le nucléaire iranien laissent présager une reprise des tensions.
La politique guerrière de Benjamin Netanyahou a montré ses limites face à un Etat capable de réagir militairement. L’Iran fragilisé émerge tout de même comme un acteur clé, capable de défier l’axe israélo-américain et de redessiner les rapports de force régionaux.