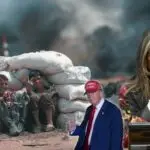C’est un document froid, sans emphase, mais implacable. Le rapport remis en juin 2025 par Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, redessine les contours d’une responsabilité collective, systémique et largement passée sous silence : celle des entreprises dans la perpétuation de l’occupation israélienne, et aujourd’hui, dans ce que le rapport n’hésite plus à définir comme une « économie du génocide ».
Dans un style mesuré mais rigoureux, le rapport A/HRC/59/23 dresse un tableau accablant. Des entreprises de l’armement à celles du cloud computing, en passant par les banques, les compagnies d’assurance, les universités ou les groupes de BTP, c’est une véritable chaîne d’approvisionnement de la violence qui est mise au jour. La guerre ne se fait pas sans logiciel, sans financement, sans bulldozers ni sans image satellite. Et dans cette guerre, les entreprises privées ont leur part.
La guerre comme niche de croissance
Depuis octobre 2023, l’armée israélienne a largué plus de 85 000 tonnes de bombes sur Gaza. Cette campagne militaire sans précédent ne se comprend pas seulement comme une réponse sécuritaire. Elle est aussi le reflet d’un système dans lequel les compétences industrielles, les savoir-faire technologiques et les innovations de surveillance sont au service d’une logique de domination territoriale.
Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, mais aussi Lockheed Martin, Boeing, Leonardo ou Rheinmetall : tous sont cités dans le rapport. Leurs drones, chasseurs F-35, bombes JDAM et autres missiles ont fait de Gaza un champ d’expérimentation grandeur nature. Ces armes sont ensuite exportées comme « battle-tested », testées sur le terrain.
Depuis 2023, Elbit Systems coopère étroitement avec les opérations militaires israéliennes, intégrant ses cadres au ministère de la Défense », note le rapport.
Le marché de l’armement est au cœur de l’économie israélienne. Mais il est aussi celui qui relie le plus directement le capital international à la violence contre les Palestiniens. Chaque contrat signé, chaque pièce détachée livrée, chaque transfert de technologie est un acte de complicité, même indirect.
L’occupation numérique
L’infrastructure de la guerre israélienne repose aussi sur la donnée. En 2021, le gouvernement israélien signait le contrat « Nimbus » avec Amazon Web Services et Google Cloud pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Officiellement, il s’agissait de moderniser les services numériques de l’État. Mais des documents internes et des alertes de salariés ont montré que ces technologies étaient mobilisées pour la surveillance, l’analyse de données et la gestion militaire.
Parallèlement, des systèmes comme « Lavender », basés sur l’intelligence artificielle, auraient permis de dresser automatiquement des listes de cibles humaines. À ce jour, ni Google ni Amazon n’ont mis fin à leur implication. Le rapport appelle les entreprises à se retirer « totalement et inconditionnellement » de toute activité liée à l’occupation.
La complicité ne s’arrête pas au cloud. Microsoft, IBM, Palantir, NSO Group et d’autres sont également mentionnés pour leur rôle dans la surveillance de masse, les outils de reconnaissance faciale et la gestion des check-points. L’apartheid se numérise, et il génère des profits.
Le soutien silencieux des banques, des universités et des assurances
Ce que le rapport dévoile, c’est aussi l’ampleur de la complicité indirecte. Les banques investissent dans les entreprises d’armement. Les compagnies d’assurance couvrent les chantiers dans les colonies. Les universités développent des programmes de recherche avec des institutions israéliennes directement impliquées dans le système colonial.
L’Université de Tel Aviv, le Technion ou Bar-Ilan sont ainsi partenaires de nombreuses multinationales. Ensemble, ils conçoivent des algorithmes, optimisent des systèmes de contrôle, testent des prototypes. Mais ces collaborations sont souvent masquées derrière le voile de la science et de l’innovation.
Les universités […] ont développé des armements, toléré ou endossé les violences systémiques, tandis que les collaborations internationales ont dissimulé l’effacement palestinien sous un voile de neutralité universitaire », lit-on dans le rapport.
Un encadrement juridique encore trop timide
Francesca Albanese ne se limite pas à dénoncer. Elle nomme, structure et interpelle. Surtout, elle rappelle que le droit international prévoit la responsabilité pénale des entreprises et de leurs dirigeants en cas de participation substantielle à des crimes de guerre, de colonisation ou de génocide.
Les Principes directeurs de l’ONU sur les entreprises et les droits humains (2011), la Quatrième Convention de Genève, les jurisprudences du Tribunal pénal international sont autant d’outils mobilisables. Mais peu de procédures voient le jour. L’inertie politique, le lobbying des multinationales et l’opacité des chaînes d’approvisionnement freinent toute réparation.
Et maintenant ?
Ce rapport pose une question simple : peut-on encore faire du profit dans un contexte de crimes de masse sans rendre de comptes ? Il invite les ONG, les parlementaires, les avocats, mais aussi les citoyens à se saisir de ce qui constitue une véritable « architecture économique du génocide ». Il appelle les États à interdire les contrats, à retirer les investissements, à rompre les coopérations.
Le silence des entreprises n’est plus tenable. Celui des gouvernements non plus. Combien de Gaza encore faudra-t-il pour que le droit prime sur les dividendes ?