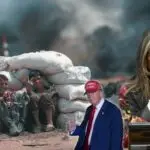Lors de la mobilisation écologiste contre le chantier de l’A69, des drapeaux palestiniens ont été déployés dont l’un sur le château de Maurens. Il n’aura fallu que quelques heures pour que certains médias, dont CNews, y voient une forme “d’antisémitisme”. Un glissement accusatoire qui en dit long sur les stratégies actuelles de disqualification de la solidarité internationale.
Mobilisation écologiste et question palestinienne
Samedi 6 juillet, dans les champs du Tarn, plusieurs centaines de militants écologistes se rassemblent à l’appel des Soulèvements de la Terre, d’Extinction Rebellion et de collectifs ruraux opposés à l’autoroute A69. L’événement, baptisé Turboteuf, mêle ateliers, débats, concerts et actions de désobéissance civile à proximité du chantier.
Dans l’après-midi, un drapeau palestinien est hissé sur la façade du château de Maurens. Un acte hautement symbolique, expliqué par les organisateurs dans leur communiqué officiel : « Colonisation ici, colonisation là-bas : même combat. » Une convergence des luttes assumée, inscrite dans la tradition anticoloniale des mouvements écologistes radicaux.
Mais dès le lendemain, CNews consacre un sujet vidéo à l’image du drapeau. Le ton est accusatoire. Sur le plateau, l’avocat Anthony Bem déclare qu’il s’agit d’un « acte antisémite », transformant une expression politique en délit moral.
C’est un acte antisémite, cela n’a rien à faire là. C’est complètement hors-sujet et cela démontre l’instrumentalisation politique du conflit à Gaza».
Un glissement dangereux
Ce n’est pas la première fois que la solidarité avec la Palestine est présentée comme suspecte, voire condamnable. Ce réflexe désormais pavlovien, d’assimiler tout soutien à Gaza à de l’antisémitisme, participe d’un climat d’intimidation de plus en plus pesant.
À aucun moment les manifestants n’ont tenu de propos haineux. Aucun slogan, aucune banderole, aucun discours ne visait la communauté juive. Le drapeau brandi sur le château n’était ni un slogan offensif ni une insulte déguisée, mais un marqueur politique clair : celui de l’opposition à toutes les formes de colonisation. Et d’un soutien aux Gazaouis, dont les terres et les corps sont aujourd’hui écrasés sous les bombes.
Dans les rangs militants, ce soutien n’est ni nouveau, ni opportuniste. Depuis plusieurs années, des ponts sont tissés entre luttes pour la terre, contre l’extractivisme, et soutien aux peuples colonisés qu’il s’agisse des Kanak ou des Palestiniens. La lutte écologiste se pense globalement, en cohérence avec les ravages du capitalisme sur les humains comme sur les écosystèmes.
Gaza : l’écocide oublié
La bande de Gaza, aujourd’hui ravagée par bientôt deux années de bombardements intensifs, est aussi le théâtre d’un écocide silencieux. Déforestation, contamination des nappes, effondrement de la biodiversité, pollution durable des sols par les métaux lourds et munitions : les chercheurs de l’environnement parlent d’une destruction systématique du vivant.
Dans ce contexte, il n’est ni absurde ni déplacé de porter un drapeau palestinien lors d’une manifestation écologiste. Bien au contraire : refuser de nommer Gaza, c’est cautionner un effacement. Et accuser d’antisémitisme ceux qui le font, c’est tordre les mots pour protéger l’inacceptable.
Quand l’indignation devient disqualification
À travers ce type de séquence, un mécanisme bien rôdé s’active : une image est sortie de son contexte, un geste est sur-interprété, une solidarité devient suspecte. En face, les militants sont sommés de se justifier, tandis que les soutiens à Gaza sont renvoyés à une culpabilité politique permanente.
Ce glissement permanent de l’engagement vers l’accusation, et l’anticolonialisme vers l’antisémitisme, n’est pas sans conséquences. Il participe à la criminalisation croissante des luttes et à la répression symbolique de toute pensée critique sur la politique israélienne.