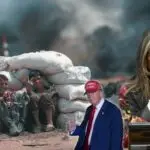13 juillet 2025. La date ne tombe pas au hasard. Ce samedi, comme chaque année, les proches d’Adama Traoré, les militants, les habitants de Beaumont-sur-Oise et bien au-delà marcheront une nouvelle fois. Neuf ans après, le combat pour la vérité n’a pas été clos par la justice. Parce qu’il n’y a pas eu de procès. Parce qu’aucun gendarme n’a été mis en examen. Parce que le silence judiciaire, au fil des années, ressemble moins à une prudence qu’à une stratégie d’épuisement. Et pourtant, ils marchent encore. Fiers et décidés.
Sur Instagram, le collectif Vérité pour Adama a donné rendez-vous ce samedi à 14h, gare de Persan-Beaumont :
9 ans sans procès. 9 ans de mensonges judiciaires. 13 juillet, on marche. »
La mémoire d’Adama s’inscrit désormais dans un rituel populaire, vivant, politique. Chaque année, à la mi-juillet, les corps reviennent dans la rue pour maintenir une vérité que l’État semble vouloir enterrer. Une foule qui tient autant de la commémoration que de l’acte d’accusation public.
Le 16 mai 2024, la cour d’appel de Paris confirme le non-lieu pour les trois gendarmes impliqués dans l’interpellation d’Adama Traoré. Neuf ans de procédure, plusieurs expertises médico-légales contradictoires, un nombre important de témoins, de versions… pour une issue prévisible : pas de mise en examen, pas de procès.
L’avocat de la famille, Yassine Bouzrou, parle d’un « non-lieu politique » et annonce un pourvoi en cassation, assorti d’une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour les proches, cette décision n’efface rien, elle confirme surtout l’asymétrie de traitement entre citoyens et forces de l’ordre.
Les expertises ont fait l’objet d’une bataille médico-légale inédite : huit rapports successifs. Certains évoquent une pathologie cardiaque préexistante, une drépanocytose, la chaleur. D’autres pointent un syndrome asphyxique dû au plaquage ventral, réalisé par trois gendarmes en simultané.
En 2023, la Défenseure des droits Claire Hédon dénonce des « manquements » dans l’intervention, notamment une mise en danger par immobilisation, et recommande des sanctions disciplinaires. Ces recommandations n’auront aucune suite.
Le nom d’Adama Traoré a largement dépassé le cadre local. Il est devenu un étendard, en France comme ailleurs, pour toutes les familles endeuillées par des violences policières. En 2020, après la mort de George Floyd, les slogans « Justice pour Adama » résonnent Place de la République, dans les cortèges antiracistes.
Sa sœur, Assa Traoré, est devenue une figure centrale de cette mémoire résistante. Dans un entretien à The Guardian, elle disait en 2023 :
I have fought every day since. » (je me bats tous les jours depuis)
Depuis, elle a remporté plusieurs procès en diffamation intentés contre des syndicats de police. Malgré les pressions, elle continue d’incarner un antiracisme ancré dans les quartiers, politique et rigoureux.
En 2023, la préfecture interdit la marche annuelle. Des rassemblements ont lieu à Paris. À la fin de l’un d’eux, Youssouf Traoré, un autre frère d’Adama, est interpellé violemment par les BRAV-M. Il est hospitalisé, la garde à vue est levée. L’image de son visage tuméfié fait le tour des réseaux.
Le lendemain, le procureur annonce l’ouverture d’une enquête… pour violences contre des agents. Ce renversement narratif est devenu classique. Les familles dénoncent une criminalisation du deuil.
Ce samedi, ils seront là. Ceux qui marchent. Ceux qui n’ont rien oublié. Ceux qui refusent de se satisfaire d’un non-lieu. Ceux qui refusent de voir cette affaire classée dans le silence.
L’affaire Traoré ne dit pas seulement quelque chose d’une tragédie individuelle. Elle révèle un système : une lenteur qui n’est pas neutre, une absence de procès qui devient structurelle, une mémoire populaire constamment encadrée.
Et pourtant, chaque année, elle revient. Inlassablement. Parce qu’à défaut de procès, il reste la marche. Parce qu’à défaut de reconnaissance, il reste la parole. Et parce qu’à défaut de justice, il reste la vérité que l’on porte.