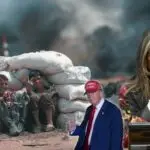Le 6 juin 2025, à Bourg-en-Bresse, la façade de l’hôtel de ville s’orne pour quelques heures d’un drapeau palestinien, hissé en solidarité avec les victimes civiles de Gaza. Un geste fort, assumé par la majorité municipale, dans le cadre d’un rassemblement citoyen pacifique. Mais dès le lendemain, le député Marc Chavent (UDR) saisit la préfecture de l’Ain pour dénoncer une « atteinte grave à la neutralité des services publics » et exiger le retrait immédiat du drapeau. La préfète s’exécute rapidement, enjoignant la mairie à démonter la bannière.
Le message est clair : en matière de politique étrangère, les collectivités n’ont pas voix au chapitre, à condition que leur message ne dérange pas la ligne gouvernementale.
Des mairies hissent le drapeau palestinien
Bourg-en-Bresse n’est pas un cas isolé. Ces derniers mois, plusieurs villes, Montpellier, Saint-Denis (en présence de l’Ambassadrice de la Palestine en France), Fontenay-sous-Bois, Carhaix, La Courneuve, Moissy-Cramayel, Trappes, Besançon, ont voulu manifester leur soutien symbolique au peuple palestinien en hissant un drapeau ou en projetant les couleurs palestiniennes sur leurs bâtiments. À chaque fois, la réaction préfectorale a été rapide et hostile : sommations écrites, pressions administratives, parfois menaces de sanctions.
Le motif invoqué est toujours le même : le principe de neutralité des bâtiments publics, tel qu’interprété par le Conseil d’État et les juridictions administratives. Une mairie ne saurait, selon cette logique, prendre position dans un conflit international, sous peine de troubler l’ordre public.
Mais ce principe, censé garantir la neutralité républicaine, est-il appliqué avec la même rigueur selon les causes soutenues ?
Un principe de neutralité à géométrie variable
Le contraste saute aux yeux quand on observe le cas de Nice, où sept drapeaux israéliens ont été déployés par la mairie sur les bâtiments publics en octobre 2023, quelques jours après les attaques du Hamas. Le maire Christian Estrosi avait alors déclaré que ces drapeaux resteraient « jusqu’à la libération de tous les otages » israéliens, une position clairement politique et assumée.
Plusieurs associations pro-palestiniennes avaient alors saisi la préfecture des Alpes-Maritimes. Aucune intervention préfectorale n’a été enregistrée. Mieux encore : le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de retrait des drapeaux israéliens, au motif que la requête ne présentait « pas de caractère d’urgence ».
Ce deux poids deux mesures interroge. D’un côté, des mairies sommées de retirer un drapeau palestinien dès son apparition. De l’autre, des mairies libres d’afficher leur soutien à Israël pendant des mois, sans réaction préfectorale, ni rappel à la loi.
Même logique à la mairie de Paris, où plutôt que d’arborer un drapeau, la maire Anne Hidalgo a choisi de projeter les couleurs du drapeau israélien sur la façade de l’Hôtel de Ville. Jean-Pierre, avocat et ancien homme politique, n’a pas hésité à lui rappeler via X.
Jurisprudence et droit : les limites de la légalité
Sur le plan juridique, les préfectures s’appuient sur plusieurs décisions anciennes du Conseil d’État et des tribunaux administratifs, notamment une décision de 2011 interdisant à la ville de Vaulx-en-Velin d’arborer un drapeau palestinien.
La motivation principale : les collectivités locales ne peuvent interférer dans la conduite de la politique étrangère de la France.
Mais ce raisonnement ne tient que si le principe est appliqué de manière égale. Or, aucune jurisprudence ne semble avoir été mobilisée pour interdire les drapeaux israéliens à Nice ou ailleurs, malgré leur présence prolongée et leur usage évident comme marqueur d’alignement politique.
Réactions sur les drapeaux palestiniens retirés
Face à cette inégalité de traitement, les critiques se multiplient. Plusieurs élus de gauche dénoncent un usage partial du droit. À Bourg-en-Bresse, le député Chavent a lui-même proposé un “équilibrage”, suggérant d’arborer à la fois le drapeau palestinien et le drapeau israélien, ce que la préfecture n’a pas retenu.
Si c’est le drapeau de la Palestine qui gêne, alors on l’affichera. Tant que le génocide continuera, tant que le droit international ne sera pas respecté, on tiendra bon. Un élu n’est pas là pour baisser la tête, mais pour défendre des principes », a déclaré Julie Garnier, conseillère régionale Ile-de-France (LFI).
Du côté de la député européenne LFI, Rima Hassan, on accuse la femme politique Shannon Seban de racisme anti palestinien.
Une centralisation autoritaire du symbole
Ce que révèle cette affaire, au-delà des seuls drapeaux, c’est la manière dont la préfecture, bras de l’État central, encadre de plus en plus strictement l’expression politique des mairies. Le droit est mobilisé comme un outil d’alignement, où l’interprétation du principe de neutralité varie en fonction du message véhiculé.
Car dans les faits, la “neutralité” exigée ne vaut que pour certains drapeaux, certaines causes, certains peuples. Ce qui est toléré pour Israël est interdit pour la Palestine. Ce qui est loué comme solidarité pour l’Ukraine devient soudain une menace à l’ordre public lorsqu’il s’agit de Gaza.
Le paradoxe est cruel : en prétendant garantir la neutralité des institutions, l’État français révèle ses choix. Loin d’arbitrer avec équité, les préfets valident une forme de hiérarchisation politique des causes : certaines vies méritent des drapeaux, d’autres non.
Ce déséquilibre, désormais bien documenté, n’est pas un accident. Il est le symptôme d’un autoritarisme symbolique croissant, où les expressions de solidarité deviennent des sujets de contentieux, selon qu’elles s’alignent ou non avec la ligne diplomatique de l’Élysée.