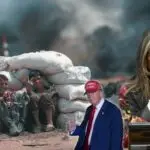Chaque été, le même refrain résonne dans les médias : « Les Français ne veulent plus travailler ». Les patrons de la restauration, du tourisme et de l’agriculture pointent du doigt une génération « fainéante » qui préfère les allocations aux emplois saisonniers. Mais derrière cette plainte patronale se cache une réalité que les éditorialistes parisiens peinent à saisir : une jeunesse qui refuse l’exploitation et transforme silencieusement le rapport de force social.
Derrière la « pénurie » des saisonniers, le refus de l’exploitation
65 000 postes saisonniers non pourvus sur la saison estivale 2022 et hivernale 2022-2023 : c’est le chiffre officiel brandi par le gouvernement pour justifier sa « feuille de route » destinée à améliorer l’attractivité des emplois saisonniers. Mais que cache vraiment cette « pénurie » ?
Sur les forums Reddit, les témoignages s’accumulent. « J’ai bossé 70 heures par semaine dans un restaurant à Cannes, payé au SMIC, logé dans un studio humide à 400 euros par mois. Quand j’ai demandé mes heures sup’, on m’a dit que c’était ‘normal’ en saison. Plus jamais », raconte un utilisateur du forum.
Ces témoignages, loin d’être anecdotiques, révèlent une réalité systémique. Le SMIC s’établit à 11,88 euros bruts de l’heure en 2025, soit 1 801 euros bruts par mois. Mais pour les saisonniers, cette référence légale cache une réalité bien plus sombre : un salaire horaire compris entre 10 et 15 euros en moyenne, auquel s’ajoutent des conditions de travail souvent illégales.
Serveur en bord de mer, 12 euros de l’heure, 12 heures par jour sans pause, logement miteux facturé 350 euros par mois », témoigne un autre saisonnier sur les réseaux sociaux.
Certains employeurs fournissent ou subventionnent le logement, mais cette « générosité » cache souvent un système de dépendance totale du salarié envers son employeur.
L’exploitation légalisée des saisonniers
On compte plus d’un million de personnes concernées chaque année par le travail saisonnier, dans un secteur où les abus sont légion. Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les huit premières, puis de 50%, mais encore faut-il qu’elles soient déclarées et payées.
La réalité du terrain est bien différente. Les horaires illégaux, les pauses supprimées, les logements insalubres facturés au prix fort, les contrats de travail non respectés : autant de pratiques qui transforment l’emploi saisonnier en piège social.
Face à cette exploitation systémique, une partie croissante des jeunes fait un choix radical : ne plus postuler. Cette année (2025), ce sont 63 000 saisonniers qui manquent à l’appel selon Nathalie Delattre, ministre déléguée au Tourisme.
Quand les patrons chouinent dans les médias
Les organisations patronales multiplient les sorties médiatiques. L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) réclame des « aides publiques » pour attirer les candidats, mais refuse catégoriquement d’évoquer une revalorisation des salaires.
Le discours patronal préfère pointer du doigt une génération « assistée » plutôt que de remettre en question un modèle économique fondé sur l’exploitation de la précarité.
« Les jeunes ne veulent plus faire d’efforts [..] Nous sommes obligés de fermer le restaurant en août », entend-on dans les médias complaisants, alors que la réalité est inverse : les jeunes refusent de faire des efforts pour des employeurs qui les méprisent.
Les réformes de l’Etat précarisent les saisonniers
Le gouvernement s’est engagé dans une approche structurante pour progressivement réduire les emplois vacants du tourisme, mais cette « approche » évite soigneusement de s’attaquer aux causes profondes du problème.
Il y a 20 ans, un boulot de saisonnier était mal payé, mais c’était sans pression, tu te faisais 3 sous pour partir en vacances avec tes potes. Maintenant c’est CDD 3 mois, 6j/7, coup de pied au c** le matin et heures supps, pression max et harcèlement », commente un internaute en dessous d’une vidéo BFM TV sur le sujet.
La réforme récente de l’assurance chômage contribue également à la précarisation et à la prétendue « pénurie » de travailleurs saisonniers. Désormais, la durée de travail d’une saison touristique s’avère insuffisante pour prétendre aux allocations chômage, contraignant de nombreux anciens saisonniers à quitter le système.
Il n’y a pas de pénurie de saisonnier, il y a des salaires et des conditions de travail de m****, et pour être saisonnier, faut toucher le chômage entre les saisons, qui a été raboté de partout », peut-on lire sur X.
La lutte des classes via les réseaux sociaux
Cette résistance silencieuse trouve ses canaux d’expression dans les espaces numériques. Forums Reddit, comptes TikTok, groupes Facebook : une génération partage ses expériences et construit collectivement une conscience de classe. Les hashtags contre la précarisation témoignent d’une politisation par le bas, loin des organisations syndicales traditionnelles.
« On n’est pas des chiens », résume un utilisateur de Reddit, synthétisant l’esprit de cette révolte diffuse. Cette formule, reprise sur les réseaux sociaux, illustre parfaitement le refus de la déshumanisation au travail. Une génération qui refuse d’être exploitée par des patrons sans vergogne.
Les métiers « que les Français ne veulent plus faire »
Le discours dominant évoque des « métiers que les Français ne veulent plus faire » qui masque la réalité : ce sont des métiers que les patrons refusent de payer décemment. Quand un poste de serveur est rémunéré 12 euros de l’heure pour 70 heures par semaine, le problème n’est pas dans la « motivation » des candidats, mais dans l’indécence de l’offre.
Dans le secteur de la construction, le taux d’emplois vacants s’élève à 6,6% dans les entreprises de 1 à 9 salariés, révélant que les difficultés de recrutement touchent particulièrement les très petites entreprises, souvent les plus exploiteuses en matière de conditions de travail.
Plutôt que d’imposer des salaires décents et des conditions de travail respectueuses, l’État préfère faciliter l’immigration de travail « choisie » pour combler les besoins du patronat.
La France organise « l’importation » de travailleurs immigrés marocains ou roumains prêts à accepter des conditions de travail extrêmement difficiles notamment dans l’agriculture et le BTP. Des politiques qui vont à l’encontre du discours ambiant contre l’immigration vendu depuis des années par les différents gouvernements de droite et du centre.
Une lutte sociale déguisée
Ce qui se joue dans cette crise des emplois saisonniers dépasse largement la question conjoncturelle du recrutement estival. C’est une véritable lutte sociale qui s’exprime par le refus et la désertion. Une grève diffuse et silencieuse qui remet en question les fondements mêmes du rapport salarial français.
Les jeunes qui refusent ces emplois ne sont pas des « assistés » ou des « fainéants » : ils sont les acteurs d’un rapport de force naissant. En refusant l’exploitation, ils contraignent le patronat à révéler sa véritable nature : celle d’un système capitaliste qui ne peut fonctionner qu’en déshumanisant le travail.
Cette résistance par le bas dessine les contours d’un nouveau mouvement social. Une génération qui refuse l’humiliation professionnelle et revendique sa dignité par le non-travail. Face à un système qui transforme l’emploi en piège social, le refus devient un acte politique.