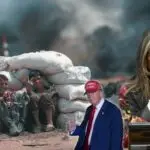Les mots de Dario Amodei, PDG d’Anthropic, résonnent comme un tocsin dans le paysage économique français. L’intelligence artificielle pourrait « éliminer la moitié des emplois de cols blancs débutants et faire grimper le chômage à 10-20 % dans les cinq prochaines années ». Derrière cette prédiction, une réalité que vivent déjà des milliers de jeunes diplômés : celle d’un marché du travail qui se dérobe sous leurs pieds.
L’alerte rouge d’un insider de la tech
Quand le patron d’une des plus importantes entreprises d’IA au monde tire la sonnette d’alarme, on écoute. Dans un entretien donné la semaine dernière, Amodei prédisait que l’IA pourrait « éliminer la moitié des emplois de cols blancs débutants et faire grimper le chômage à 10-20 % dans les cinq prochaines années ». Cette déclaration fracassante n’émane pas d’un syndicaliste en colère ou d’un sociologue alarmiste, mais bien de celui qui développe ces technologies.
« Les gens devraient s’inquiéter de perdre leur emploi au profit de l’IA », martèle Amodei. Sa franchise détonne dans un secteur habitué aux euphémismes et aux promesses d’« augmentation » plutôt que de remplacement. Car le dirigeant d’Anthropic ne mâche pas ses mots : « les outils développés par son entreprise et ses concurrents pourraient éliminer la moitié des emplois de col blanc (administration, gestion, finance, conseil…) de niveau débutant, et ce d’ici cinq ans à peine ».
Cette prédiction soulève une question fondamentale : comment une société peut-elle fonctionner quand l’échelon d’entrée sur le marché du travail disparaît ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit : non pas d’une transformation, mais d’une évaporation pure et simple des postes traditionnellement occupés par les jeunes diplômés.
Le déni d’OpenAI face à la réalité du terrain
Face à ces projections alarmantes, la concurrence tente de rassurer. Brad Lightcap, directeur des opérations d’OpenAI, balaie d’un revers de main les prédictions de son concurrent. Selon lui, « OpenAI n’a pas observé de preuves soutenant un déplacement d’emplois à si grande échelle ». Cette position, qui se veut apaisante, sonne pourtant comme un déni de la réalité vécue par des milliers de jeunes actifs.
Car pendant que les dirigeants de la tech se querellent sur l’ampleur du phénomène, les données parlent d’elles-mêmes. Les témoignages affluent : des recruteurs qui admettent sans détour que « l’IA fait ce que faisaient les stagiaires et les jeunes diplômés ». Des entreprises qui préfèrent embaucher des profils expérimentés équipés d’outils d’IA plutôt que de former des juniors.
Cette stratégie révèle une logique implacable : pourquoi investir dans la formation d’un débutant quand un senior armé de ChatGPT peut abattre le même travail en un temps record ? Le calcul économique est brutal mais cohérent pour les entreprises. Pour les jeunes diplômés, c’est un couperet.
Des chiffres qui ne mentent pas
Les statistiques françaises donnent le vertige. Au niveau national, parmi les 15-29 ans, le taux de chômage des diplômés du supérieur (12 %) est beaucoup plus faible que celui des jeunes au plus diplômés du baccalauréat (28 %).
Ces 12 % de chômage chez les diplômés du supérieur représentent des dizaines de milliers de jeunes qui ont joué le jeu du système éducatif, accumulé les années d’études, souvent contracté des dettes, pour se retrouver face à un mur. Un mur digital qui se dresse entre eux et l’emploi.
La situation est d’autant plus cruelle que ces jeunes ont été formés selon un modèle qui ne correspond plus aux réalités du marché. Pendant qu’ils apprenaient la théorie économique ou les fondamentaux du marketing, l’IA perfectionnait sa capacité à rédiger des rapports, analyser des données, produire des contenus. Les compétences qu’ils ont acquises sur les bancs de l’université sont déjà obsolètes avant même leur premier entretien d’embauche.
L’université à la traîne, les étudiants piégés
Le système éducatif français, engoncé dans ses traditions et ses rigidités bureaucratiques, peine à prendre la mesure de cette révolution. Les universités continuent de dispenser des cursus conçus pour un monde qui n’existe plus. Les étudiants en gestion apprennent encore à faire des calculs que l’IA résout en quelques secondes. Ceux en communication étudient des stratégies que les algorithmes optimisent en temps réel.
Cette inadéquation n’est pas accidentelle : elle révèle l’incapacité structurelle du système éducatif à anticiper les mutations économiques. Quand il faut des années pour réformer un cursus universitaire et quelques mois pour qu’une IA maîtrise de nouvelles compétences, le décrochage est inévitable.
Les étudiants se retrouvent ainsi dans une situation kafkaïenne : ils doivent continuer à jouer selon les règles d’un jeu dont les règles ont changé à leur insu. Ils accumulent des diplômes qui perdent de leur valeur marchande au fur et à mesure qu’ils les obtiennent.
La génération sacrifiée parle
Sarah, 24 ans, diplômée d’une école de commerce parisienne, enchaîne les entretiens depuis huit mois. « On me dit que mon profil est intéressant, mais qu’ils cherchent quelqu’un avec plus d’expérience. Comment je peux avoir de l’expérience si personne ne me donne ma chance ? », s’interroge-t-elle, amère.
Maxime, 26 ans, master en marketing digital, a vu son stage se transformer en désillusion. « J’étais censé gérer les réseaux sociaux et créer du contenu. Au final, mon maître de stage utilisait ChatGPT pour tout et je ne servais qu’à valider. Au bout de trois mois, ils m’ont dit que finalement, ils n’avaient pas besoin d’embaucher. »
Ces témoignages, nous les collectons par centaines. Ils dessinent le portrait d’une génération prise au piège entre un système éducatif qui lui promet l’ascension sociale par le diplôme et un marché du travail qui n’a plus besoin de ses compétences traditionnelles.
L’effondrement de l’ascenseur social
Ce qui se joue aujourd’hui dépasse la simple question de l’emploi des jeunes. C’est l’effondrement d’un modèle social qui structurait la société française depuis des décennies. Le parcours « études supérieures → stage / alternance → CDI → carrière » ne fonctionne plus. L’IA agit comme un acide qui corrode les premiers échelons de cette échelle sociale.
Cette rupture a des conséquences politiques majeures. Comment maintenir la cohésion sociale quand les classes moyennes diplômées ne peuvent plus reproduire leur statut social ? Comment justifier l’investissement massif dans l’enseignement supérieur quand les débouchés s’évaporent ?
Les réponses politiques restent cruellement insuffisantes. Pendant que les gouvernements successifs parlent de « transition numérique » et de « formation tout au long de la vie », des milliers de jeunes diplômés voient leurs perspectives d’avenir s’assombrir. Les dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle, conçus pour un marché du travail traditionnel, sont inadaptés à cette révolution technologique.
Quand l’IA creuse les inégalités
L’ironie de la situation est saisissante : une technologie présentée comme démocratique et accessible creuse en réalité les inégalités. Les jeunes issus de milieux favorisés peuvent se permettre d’attendre, de multiplier les formations, de bénéficier du soutien familial. Les autres se retrouvent rapidement en situation de précarité.
Cette fracture se double d’une fracture territoriale. Dans les métropoles, quelques emplois hautement qualifiés résistent encore à l’automatisation. En province, les opportunités se raréfient. Le diplôme, censé être un passeport pour la mobilité sociale, devient un piège qui maintient les jeunes dans l’illusion d’un avenir professionnel qui n’existe plus.
Vers un nouveau modèle économique ?
Face à cette situation, certains prônent le revenu universel, d’autres misent sur la création de nouveaux emplois « augmentés » par l’IA. Mais ces solutions, si elles méritent d’être débattues, ne résolvent pas le problème immédiat : que faire des milliers de jeunes diplômés qui frappent aujourd’hui aux portes d’un marché du travail qui ne veut plus d’eux ?
La réponse ne peut pas être uniquement technique ou économique. Elle doit être politique. Il faut repenser fondamentalement notre rapport au travail, à la formation, à la valeur. L’IA nous force à affronter des questions que nous préférions éviter : à quoi sert le travail ? Comment distribuer les richesses dans une société où la production peut se passer de la main-d’œuvre humaine ?
L’urgence d’agir
Les prédictions de Dario Amodei ne sont pas de la science-fiction. Elles décrivent une réalité déjà en marche. Chaque jour qui passe sans réaction politique forte condamne un peu plus une génération entière à la précarité.
L’État français, les universités, les entreprises : tous ont une responsabilité dans cette crise qui s’annonce. Mais c’est aussi aux principaux concernés, ces jeunes diplômés, de s’organiser, de faire entendre leur voix, de refuser d’être les victimes silencieuses de cette révolution technologique.
Car derrière les pourcentages et les prédictions, il y a des vies, des projets, des espoirs. L’IA peut remplacer beaucoup de choses, mais elle ne doit pas remplacer notre humanité ni notre capacité à construire ensemble une société plus juste.